Courrier aux Maires de la Charente – Loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
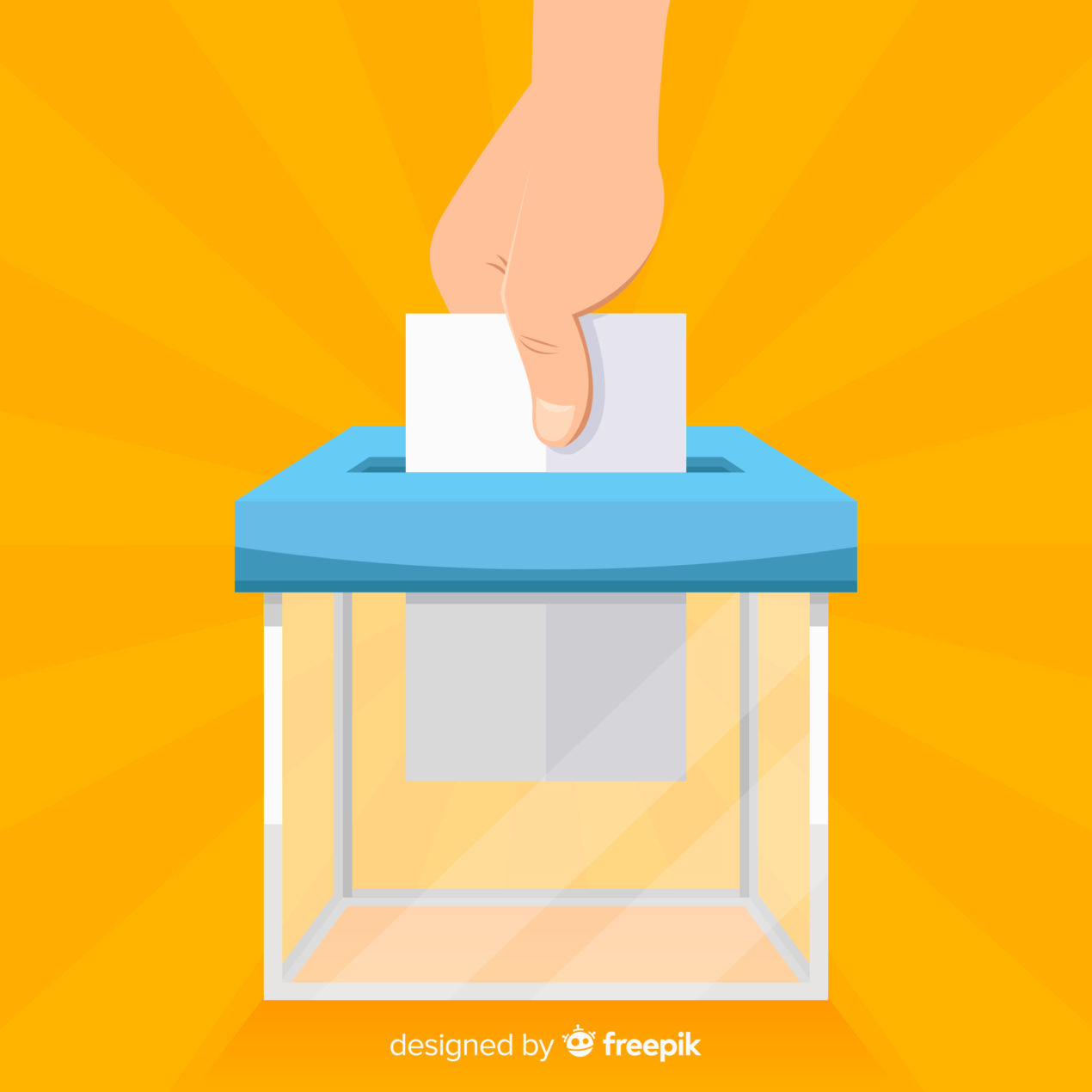
Madame le Maire,
Monsieur le Maire,
Le Parlement vient d’adopter une importante réforme électorale qui étend aux communes de moins de 1.000 habitants le scrutin de liste aujourd’hui appliqué dans celles de plus de 1 000 habitants.
Ainsi, à compter du prochain renouvellement général, c’est-à-dire lors des prochaines élections municipales du printemps 2026, l’élection dans les communes de moins de 1.000 habitants n’aura plus lieu au scrutin uninominal majoritaire mais au scrutin de liste proportionnel paritaire.
Depuis la loi « Engagement et proximité » de 2019 qui fixait l’objectif d’une révision du code électoral avant le 31 décembre 2021 pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes, cette généralisation du scrutin de liste aux communes de moins de 1.000 habitants a progressivement cheminé jusqu’à s’imposer avec force, y compris parmi les associations nationales représentatives des élus.
Pour ma part, je suis convaincue que cette extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1.000 habitants peut constituer un outil puissant de rénovation démocratique.
Aujourd’hui le scrutin majoritaire et la pratique du panachage favorisent une personnalisation excessive du vote. Le fait, pour un citoyen, de rayer des noms sur une liste entre en contradiction avec l’essence du vote, qui est de voter non pas contre un individu pour se débarrasser de tel ou tel élu, mais bien pour un projet. Avec l’extension du scrutin de liste à l’ensemble des communes il en sera fini de cette pratique injuste du « tir aux pigeons » qui pénalise les maires et les adjoints les plus exposés.
Cette réforme sera également un puissant accélérateur en faveur d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il ne parait plus acceptable aujourd’hui que les communes de moins de 1 000 habitants demeurent les seules collectivités à ne pas être concernées par le principe constitutionnel de parité. La part des femmes dans les conseils municipaux y est inférieure de plus de dix points – 37 % contre 48 % – à celle des autres communes. Si la part des femmes dans les conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants augmente – de plus de trois points entre 2014 et 2020 – cette progression reste très modeste et il faudrait, à ce rythme, attendre plus de vingt ans pour atteindre la parité dans ces communes.
Si pour ces raisons cette réforme a fini par convaincre un nombre croissant d’élus locaux, elle suscite aussi quelques inquiétudes. Il faut les entendre et y apporter des réponses :
1. Certains craignent qu’une telle réforme vienne aggraver la crise de l’engagement local. A l’issue des travaux que nous avons conduits au Sénat, je crois à l’inverse que cette réforme lui apporte une réponse.
La réalité de cette crise est aujourd’hui parfaitement établie. Au premier tour des élections municipales de 2020, quelque 106 communes ne disposaient d’aucun candidat. À l’issue du renouvellement général, 345 communes disposaient d’un conseil municipal incomplet. Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux qui avaient été observés en 2014, quand 74 communes étaient restées sans candidats et 228 sans conseil municipal complet.
Le nombre de démissions en cours de mandat s’établit quant à lui à un niveau inédit : au 7 février 2025, pas moins de 2.647 maires, soit 7,6 % des maires, avaient démissionné de leur mandat, avec une prépondérance dans les communes de moins de 1 000 habitants. On recensait également près de 30.000 démissions de conseiller municipal à mi-mandat.
Cette situation engendre pour les conseils municipaux des petites communes des difficultés de fonctionnement que chacun de nous ne connaît que trop bien.
Les facteurs de crise des vocations électorales au niveau local sont multiples. En tête figure bien entendu la dégradation des conditions d’exercice des mandats locaux, à laquelle nous avons tenté de répondre au travers de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, dont je souhaite qu’elle soit rapidement inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Ce texte devrait constituer une priorité politique.
Ma conviction est que l’actuel mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants n’est pas sans lien avec les difficultés rencontrées par les élus pour trouver des candidats. Le scrutin uninominal constitue sans aucun doute un frein à l’engagement des citoyens qui peuvent redouter de se soumettre « seul » au suffrage de leurs concitoyens.
A l’inverse, le scrutin de liste, parce qu’il oblige à la constitution d’une équipe municipale réunis autour d’un projet politique peut lever les résistances à l’engagement.
2. D’aucuns redoutent la difficulté à trouver des candidates en nombre suffisant pour constituer leur liste. Cette crainte s’exprime chaque fois qu’il s’agit de renforcer la parité. C’était le cas lors de l’extension du scrutin de liste aux communes entre 1000 et 3500 habitants, mais également lors de l’adoption du binôme paritaire pour les élections départementales. Finalement, la mise en œuvre de ces réformes n’a pas suscité de difficultés particulières.
Le niveau d’engagement des femmes dans les petites communes de nos territoires n’est aujourd’hui plus à prouver. D’ailleurs dans les communes de moins de 1 000 habitants, la proportion de maires femmes est supérieure de plus de trois points à celle qu’on constate dans les autres communes.
3. Enfin certains s’inquiètent d’un dispositif trop rigide qui ne prendrait pas en compte les spécificités des petites communes. Cette préoccupation est bien légitime et c’est pourquoi cette généralisation du scrutin de liste ne signifie pas uniformisation.
Le texte prévoit quatre aménagements pour garantir un dispositif opérationnel, suffisamment souple et adapté aux petites communes.
Premièrement, il sera possible de déposer des listes incomplètes présentant deux candidats de moins que l’effectif légal. Il sera également possible de déposer des listes comportant deux candidats supplémentaires à l’effectif légal.
En conséquence de quoi, dans les communes de moins de 1.000 habitants, les listes pourront comporter :
> entre 5 et 9 candidats pour les communes de moins de 100 habitants ;
> entre 9 et 13 candidats pour les communes de 100 à 499 ;
> entre 13 et 17 pour les communes de 500 à 999.
Deuxièmement, le principe de complétude du conseil municipal, aujourd’hui réservé aux seules communes jusqu’à 499 habitants est étendu aux communes de 500 à 999 habitants dès lors que celui-ci compte jusqu’à 2 membres de moins que l’effectif légal. Ainsi, pour les communes entre 500 à 999 habitants dont l’effectif légal du conseil municipal est de quinze membres, un conseil sera réputé complet s’il compte treize membres.
Troisièmement, alors que dans les communes de plus de 1.000 habitants, il est prévu un renouvellement intégral du conseil municipal lorsque celui-ci a perdu le tiers ou plus de ses membres, il a été décidé pour ne pas risquer de multiplier les élections partielles intégrales dans les communes de moins de 1.000 habitants d’y maintenir le principe des élections complémentaires pour les seuls sièges vacants. Dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs sièges à pourvoir, les candidats se présenteraient sous forme de liste.
Enfin, quatrièmement, alors que dans les communes de plus de 1.000 habitants, un adjoint est remplacé, en cas de vacance, par un conseiller municipal de même sexe, ce ne sera pas le cas dans les communes de moins de 1.000 habitants pour tenir compte de l’effectif réduit des conseils municipaux dans ces communes.
Ainsi, c’est une réforme ambitieuse dans ses objectifs et pragmatique dans ses modalités qui va entrer en vigueur. Elle vient parachever un long processus en faveur de la parité dans nos communes. Surtout, c’est un texte qui permettra sans nul doute de favoriser l’engagement de nos concitoyens car au travers du scrutin de liste, c’est un projet, une équipe, une dynamique collective qui pourront être pleinement mis en œuvre.
Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.